QUI sont-ils ? Épisode 15
15e épisode de notre série sur les personnages historiques. Ils ont donné leur nom à une avenue, une rue, ou une place de notre territoire. Des noms qui nous sont devenus familiers au fil du temps, mais dont nous ignorons tout ou presque. Partons à la découverte de ces femmes et hommes au parcours souvent hors du commun.
Carmen Bazan
Un passage à Oloron-Sainte-Marie, reliant les allées du Comte de Tréville et la rue Louis Barthou, lui rend hommage. Carmen Bazan est née en 1913 en Catalogne. Infirmière de formation et républicaine convaincue, elle combat le franquisme de toutes ses forces. Réfugiée ensuite à Oloron-Sainte-Marie avec son époux, elle est agent de liaison pour le maquis de Pedehourat lors de la Seconde Guerre mondiale. À bicyclette, elle transmet messages, armes, argent et médicaments. Le 17 juillet 1944, alors qu'elle accompagne un réfugié espagnol, elle est témoin du massacre de Buziet perpétré par l’occupant. Ce jour-là, les troupes allemandes mènent une opération dans le village béarnais contre le maquis et exécutent sommairement dix personnes, 8 résistants espagnols et 2 Françaises. Carmen Bazan est décédée en 2000. En 2013, lors de la commémoration du centenaire de sa naissance, une passerelle est inaugurée au-dessus du Gave à Oloron-Sainte-Marie. Ses trois enfants sont présents. Dora qui vit en Béarn, Félix venu du Pas de Calais, et Blanche qui a traversé l’Atlantique depuis San Francisco (États-Unis). Comme le souligne Bernard Uthurry, Maire de la Ville, « Carmen Bazan fait partie de ces Espagnols, privés de leur liberté dans leur pays, qui sont venus nous aider à reconquérir la nôtre ».
Cyprien Despourrins 
Plusieurs rues béarnaises sont baptisées de son patronyme. Né à Accous en 1698, Cyprien Despourrins demeure l’un des poètes les plus emblématiques du Béarn. Auteur de chansons en langue d’oc, il marque son époque par des textes simples et touchants, parmi lesquels Rossinholet qui cantas et Quant vòs ganhar pastoreta charmanta. Ses oeuvres, rédigées dans le béarnais de la plaine, connaissent un succès immédiat. Elles sont popularisées jusque dans les salons parisiens grâce au ténor Pierre de Jélyotte, qui les fait découvrir à la marquise de Pompadour. En hommage, un obélisque (voir photo) est érigé à Accous. Son socle porte des textes du poète agenais Jasmin et du Béarnais Xavier Navarrot, ainsi qu’un bas-relief représentant trois épées, rappel d’un exploit héroïque de son père en 1674. Héritier du Château de Miramont à Adast dans les Hautes-Pyrénées, Despourrins y passe ses dernières années et s’éteint en 1759. Par son œuvre, il a contribué à préserver et à magnifier la langue béarnaise, inscrivant ses chansons dans la mémoire collective d’un pays dont il demeure une figure tutélaire.
Louis de Foix 
Un Lycée professionnel et une avenue portent son nom à Bayonne, ainsi qu’une rue à Bordeaux et Royan. Né vers 1535 à Paris, Louis de Foix reste une figure aussi mystérieuse que fascinante. Horloger de formation, il entre au service de Philippe II d’Espagne vers 1560, où ses talents de mécanicien et d’ingénieur le mènent jusqu’au chantier colossal de l’Escurial, près de Madrid. De retour en France, Charles IX lui confie en 1571 une mission d’envergure : détourner le cours de l’Adour pour redonner vie au Port de Bayonne. Après sept années de travaux, une crue parachève son oeuvre, faisant de lui « L’homme qui vola le fleuve ». Visionnaire et obstiné, Louis de Foix se consacre ensuite au phare de Cordouan, à l’embouchure de la Gironde. Dix-huit années de labeur et toute sa fortune y passent. S’il meurt avant son achèvement, son fils Pierre, puis François Beuscher poursuivent l’ouvrage, inauguré en 1611 et phare français le plus ancien encore en activité. Ni sa date de naissance exacte ni celle de sa mort - entre 1602 et 1606 - ne sont connues. Mais son nom reste indissociable de Cordouan, « Versailles des mers », où il serait secrètement enterré selon une légende du XVIIIe siècle. Un buste lui rend d’ailleurs hommage dans la chapelle du phare (voir photo). Architecte, ingénieur et poète de la pierre, Louis de Foix demeure l’un des grands artisans de la Renaissance française.
Maurice Ravel 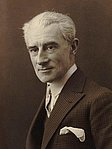
De nombreuses voies, établissements scolaires et conservatoires célèbrent le compositeur basque. Né le 7 mars 1875 dans la Maison Estebania à Ciboure, Maurice Ravel demeure l’un des compositeurs français les plus marquants du XXe siècle. Aux côtés de Claude Debussy, il incarne le renouveau musical d’une époque qui cherche à conjuguer tradition et modernité. Auteur d’une oeuvre relativement restreinte – 86 partitions originales –, Ravel a su marier l’héritage de Couperin et Rameau aux rythmes venus d’Espagne et du jazz. Ses créations couvrent une grande diversité de genres, du ballet Daphnis et Chloé aux concertos pour piano, sans oublier sa magistrale orchestration des Tableaux d’une exposition de Moussorgski. C’est pourtant le Boléro, composé en 1928 pour Ida Rubinstein, qui fait sa gloire internationale. Construit sur une obsession rythmique et mélodique, ce « ballet de caractère espagnol » a conquis le monde en quelques mois, devenant malgré lui son oeuvre la plus populaire. Artisan perfectionniste, reconnu comme un maître de l’orchestration, Ravel a mené une vie discrète entre Paris, Montfortl’Amaury en Seine-et-Oise, et le Pays Basque. Atteint d’une maladie cérébrale dès 1933, il est contraint petit à petit à renoncer à l’écriture et décède le 28 décembre 1937 à Paris, à l’âge de 62 ans. Sa sépulture se trouve au cimetière de Levallois-Perret. Sa musique, entre intelligence et sensibilité, continue de résonner sur toutes les scènes du monde.


